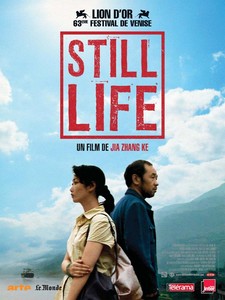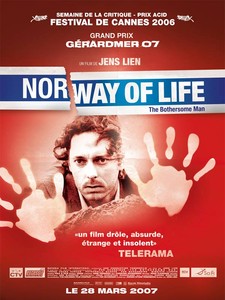de Sarah Polley
Comme on pouvait s’y attendre, le premier film de Sarah Polley est un joli film, sincère et assez émouvant. On aurait voulu mieux, mais enfin, c’est encore pas tout à fait ça. Elle a du courage, Sarah Polley. Le sujet est ultra casse-gueule, et aurait pu facilement sombrer dans le mélo. Ce n’est pas le cas.
Grant et Fiona (sublimissime Julie Christie, à la silhouette juvénile malgré ses 66 ans), mariés depuis 44 ans et encore amoureux. Elle commence à perdre la boule, les mots, elle commence à disparaître et pousse son mari réticent à la coller dans une maison spécialisée.
Plusieurs choses très réussies dans ce film. Les personnages secondaires sont dessinés en quelques plans avec une grande justesse, la directrice de l’établissement, sourire ultra-bright et dynamisme à l’américaine qui se décompose quand on lui résiste, l’infirmière à l’écoute, mais à l’honnêteté déstabilisante, ou le pensionnaire, ancien commentateur sportif, qui n’a jamais réussi à prendre sa retraite et commente à tout va, y compris les attitudes des gens quand il les croise . Sarah Polley dessine aussi très bien le trouble qui s’insinue en Grant quand il s’aperçoit que dans son centre, sa femme est tombée amoureuse d’un autre homme, Aubrey. Fiona a toujours été une personnalité un peu à part. Est-elle vraiment amoureuse d’Aubrey ? Ou fait-elle semblant soit pour faire payer à son mari son infidélité passée, ou au contraire pour l’aider à ce qu’il se détache d’elle tout à fait, et l’épargner au moment où elle ne sera vraiment plus elle-même ? Réussis aussi, les petits gestes de recul ou d’affection à peine esquissés. On sent la réalisatrice sensible et attentive à ses personnages.
Malgré tout ça, et comme dans La vie secrète des mots d’Isabel Coixet dont Sarah Polley était l’héroïne, et dont visiblement elle s’inspire beaucoup, la sauce ne prend jamais tout à fait. Filmer les regards vagues et mélancoliques de ses deux principaux protagonistes ne suffit pas toujours, surtout accompagnés d’une si mauvaise musique (je pense qu’elle a dû choisir des trucs libres de droits, sinon, je vois pas), et de si mauvais brushings (il faut pendre le coiffeur de Julie Christie). Pourtant certaines maladresses sont assez charmantes ( un petit skieur qui s’évanouit et réapparaît pour simuler la transmission neuronale défaillante, ou les fenêtres d’une maison qui s’éteignent une à une pour la mémoire qui s’efface petit à petit), et on sent parfois poindre un assez joli sens de la mise en scène.
Cependant, excès de pudeur peut-être, elle ne va pas assez loin dans son sujet, la cruauté terrible de la maladie d’Alzheimer, la perte des souvenirs qui est la perte de soi, l’intolérable injustice de cette affection, les mots parfois insoutenables des malades. Le truc est trop scénarisé, sûrement tiré d’un bouquin, le montage, avec ces flashforwards maladroits et inutiles, hache inutilement le film. Dommage. Mais j’attends le deuxième avec impatience.