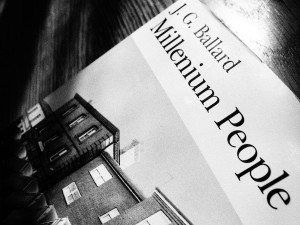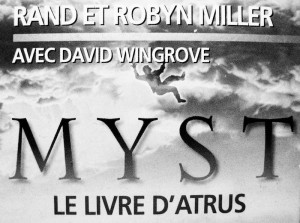de J. G.Ballard
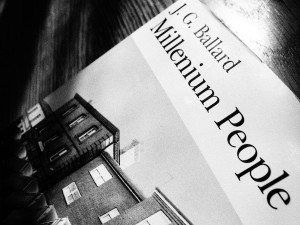 Millenium People est un des derniers livres du cultissime James Graham Ballard, auteur entre autres du dérangeant Crash ! Ecrit à 75 ans, Millenium People montre que si le potentiel subversif de son auteur était encore absolument intact en 2005, son écriture par contre montrait de gros signes de faiblesse.
Millenium People est un des derniers livres du cultissime James Graham Ballard, auteur entre autres du dérangeant Crash ! Ecrit à 75 ans, Millenium People montre que si le potentiel subversif de son auteur était encore absolument intact en 2005, son écriture par contre montrait de gros signes de faiblesse.
Millenium People raconte, pour vous la faire courte, la révolte londonienne d’une classe moyenne prise au piège d’un capitalisme fascisant. Prenant conscience que tous leurs rêves et leurs choix de vie sont dictés par la société libérale dans laquelle ils évoluent, les habitants d’une résidence de standing commencent à casser leur jouet en s’en prenant aux symboles de leur aliénation : parcmètres, écoles privées, charges locatives, vidéoclubs, cinémathèque, musées et agences de voyage. Mais, perdus parmi ces actes de rébellion et de vandalisme une série d’attentats gratuits et non revendiqués commencent à faire frémir la ville. David, un psychologue dont l’ex-femme est morte dans l’un de ces attentats, infiltre la résidence pour découvrir les raisons de cet acte et leur auteur. Et puis sans doute aussi pour se trouver lui-même.
Le thème développé par Ballard est très intéressant et sans doute prophétique. La société (anglaise, mais pas que) “tient” en partie par ses classes moyennes, qui représente un “modèle” à atteindre pour les classes moins favorisées. Mais la douillette sécurité que représente l’atteinte de cette classe moyenne n’est qu’apparente : l’augmentation du coût de la vie fait que l’ensemble des objectifs, des rêves de cette population (objectifs et rêves formatés, biberonnés dès l’enfance dans des écoles privées, et par la société de consommation en général), devient d’un coup hors de portée. Cette classe moyenne se mue alors en symbole d’une impasse sociétale, dont l’implosion signifierait l’explosion d’un système tout entier.
Les propos de J. G. Ballard ne perdent rien de leur potentiel subversif. La réflexion sur “le vide” et “l’ennui” m’a particulièrement intéressée. Sans pouvoir d’achat les classes moyennes perdent le sens même de leur existence (la consommation, matérielle, culturelle, touristique…). Privées de leurs béquilles, elles sont confrontées au vide absolu de leurs existences, et commencent alors à détruire les symboles même de ce qui les qualifie. Tout comme Sally, la femme de David, ne peut se séparer de ses béquilles après un accident (dépourvu de ce fait d’une quelconque signification) dont elle s’est pourtant parfaitement remise. Le constat est désespérant, l’homme ne pouvant supporter l’absence totale de sens de l’existence, ne peut vivre sans béquille qu’elle soit spirituelle, matérielle ou culturelle.
Le gros problème de Millenium People, c’est sa construction et son écriture. La construction, beaucoup moins rigoureuse que celle des précédents romans du maître, rend la lecture souvent peu claire. Abus de flash-forward à l’intérieur même de paragraphes, écriture peu précise, rendent le roman passablement confus. L’édifice tient maladroitement debout, les personnages restent difficiles à définir et à comprendre, les dialogues, à force de sous-texte, en deviennent complètement obscures. De nombreuses formules, à la limite de la correction grammaticale, font également penser à un problème de traduction, visiblement pas très travaillée.
On le sait, après avoir lu l’autobiographie au titre infâme de Ballard La vie et rien d’autre, la maître était devenu terriblement popote sur la fin de sa vie. Et Millenium People révèle toute la complexité de cet esprit paradoxal : à jamais subversif sur le fond, totalement mollissant sur la forme.
Ed. Denoël (en poche chez Folio)
Trad. Philippe Delamare
 Dans une pièce vide au plancher nu, un homme regarde par une fenêtre au carreau cassé. Et c’est tout. Voilà l’histoire de Tout passe, minuscule roman (par le nombre de ses pages), mais grand roman (par la beauté de son texte). Tout passe est un petit objet minimaliste, pointilliste, impressionniste dans le sens où il “impressionne” l’esprit du lecteur, il le marque d’images, de musique et de mots.
Dans une pièce vide au plancher nu, un homme regarde par une fenêtre au carreau cassé. Et c’est tout. Voilà l’histoire de Tout passe, minuscule roman (par le nombre de ses pages), mais grand roman (par la beauté de son texte). Tout passe est un petit objet minimaliste, pointilliste, impressionniste dans le sens où il “impressionne” l’esprit du lecteur, il le marque d’images, de musique et de mots.