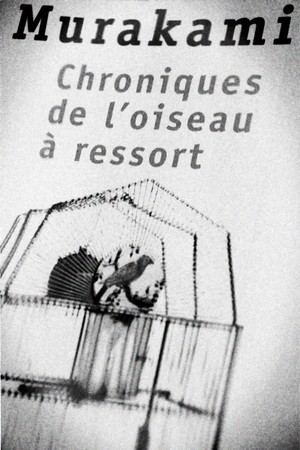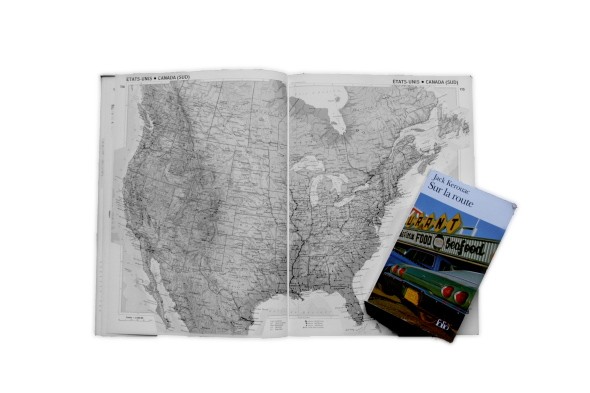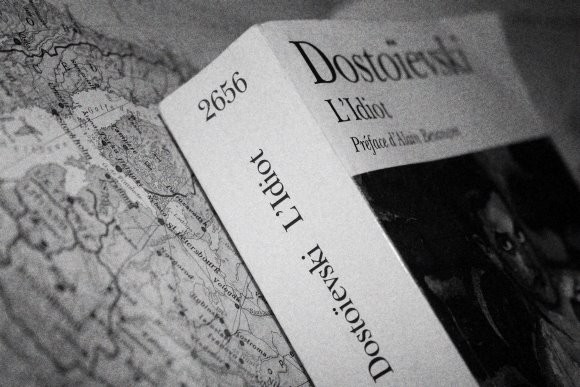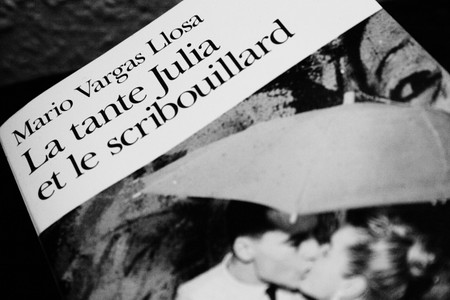d’Haruki Murakami.
L’histoire commence lors de la disparition du chat de Toru et Kumiko. Non, en fait, c’est sûrement au moment de l’avortement de Kumiko que l’histoire a réellement débuté. En réfléchissant un peu plus loin, c’est peut-être bien lorsque la ruelle derrière chez eux a été bouchée que les choses ont vraiment déraillé, ou peut-être bien quand le puits des voisins s’est asséché. Mais non finalement, les racines du trouble sont sans doute plus profondément ancrées dans l’histoire japonaise, dans les terres mandchoues.
Dans Chroniques de l’oiseau à ressort, c’est comme ça, on n’est jamais sûr de rien. Le héros, Toru, bonne pâte d’une affligeante et incroyable passivité (ou ouverture d’esprit, c’est selon), se voit embarqué dans une spirale d’événements assez incompréhensibles, en apparence disjoints. On le suit dans sa quête (récupérer sa femme), perplexe sur sa méthode, mais reconnaissant qu’elle est plutôt efficace. Beaucoup plus cohérent et moins poseur que Kafka sur le rivage, Chroniques de l’oiseau à ressort est une pure merveille, qui m’a emmené très loin de mes bases et certitudes, dans une espèce de monde parallèle, pourvu de sa logique propre, de ses codes, de sa vérité. Car c’est bien de vérité qu’il s’agit ici. Dans notre monde sûr de ses fondamentaux, Murakami s’ingénie à saper nos croyances matérialistes et rationnelles. « La vérité n’est pas forcément dans la réalité, et la réalité n’est peut-être pas la seule vérité« .
Il s’agit également de libre-arbitre , les personnages sont ici lancés dans un histoire qui les dépasse, et trouver des marges de manoeuvre et de contrôle des événements est très difficile. C’est absolument fascinant, ça se lit comme on mange une tartine de beurre salé, et quand on arrive à la fin, on a la véritable impression que les mystères sont résolus. Fort heureusement, en y réfléchissant bien, ce n’est pas du tout le cas. Tant mieux, de quoi cogiter et rêver encore un bon petit moment.