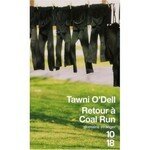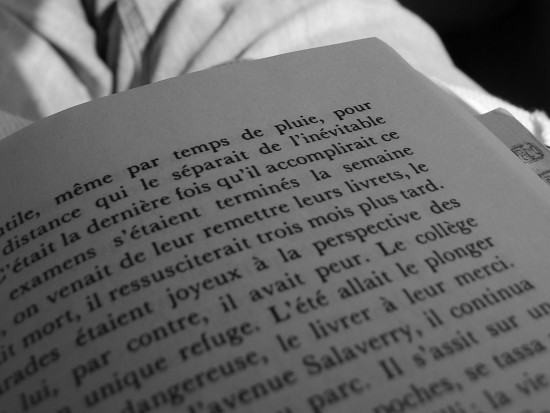de Giles Foden.
Tombée par hasard sur le livre après avoir malencontreusement loupé le film, j’ai mis un moment à oser l’ouvrir. Le thème, il faut l’avouer est peu sexy au premier abord, et comme parfois les apparences sont trompeuses.
Le bouquin relate l’histoire de Nicholas Garrigan, jeune médecin écossais, envoyé tout d’abord dans la cambrousse ougandaise, puis au service d’Idi Amin Dada. Roman d’apprentissage, d’aventure, historique, on est plongé dès les premières pages dans un foisonnement incroyable et pourtant d’une limpide. Malgré le jeune âge de l’auteur à la sortie du roman (seulement 31 ans), l’écriture est d’une maturité impressionnante et d’une grande beauté. Langage de dandy, mais d’une remarquable fluidité, c’est un régal à savourer, en dépit du thème pour le moins sérieux.
Le narrateur, personnage d’un caractère passif, raconte de façon assez distanciée les horreurs ougandaises. Cette distance, représentant autant du détâchement, de l’inconscience, qu’une forme de protection face aux atrocités auxquelles il assiste, tombe par moment, pour laisser place à quelques paragraphes d’une grande humanité et recul sur soi-même. Ces petites incursions dans la conscience humaine permettent au roman, et au héros, d’échapper à la banalité d’une simple récit à la troisième personne, et lui donnent une ampleur assez inattendue. Plus que la volonté de raconter un pan de l’Histoire travers d’un témoin (le coup d’Etat d’Amin Dada pour arriver au pouvoir en Ouganda, puis la désagrégation du pays, soumis à la dictature d’un fou), c’est donc surtout le rapport de l’Homme aux événements auxquels il assiste et, de manière non désirée, auxquels il prend part. Malgré la façon dont Garrigan clame son innocence, essaie de s’auto-convaincre qu’il n’est pour rien dans tout ce qui est arrivé, il s’exile dans une île coupée du monde pour finir ses jours. Culpabilité inconsciente, ou volonté de s’éloigner des atrocités du monde. Un peu des deux peut-être.
Evidemment le livre est historiquement très intéressant pour qui connaît peu ou pas l’histoire de l’Ouganda, sans tomber (à une petite et pardonnable exception près) dans la pédagogie de livre scolaire. Un grand bravo à François Lasquin et Lise Dufaux pour la belle traduction.
Quelques lignes pour le plaisir :
« Mais à l’époque, je ne laissai pas percer grand-chose de ce que j’éprouvais : alors que j’avais hérité de ma mère une propension à travailler d’arrache-pied et à me ronger les sangs pour des riens, mon père m’avait inculqué l’idée que si l’on veut réussir dans la vie, il importe de juguler ses sentiments. Chez nous, la manie de « s’exprimer » à tout prix que l’on pare aujourd’hui de toutes les vertus n’avait certes pas cours. Si bien qu’enfant, ma folie juvénile resta sagement confinée dans ma tête qui bouillonnait d’envies vagabondes : j’avais la passion des atlas, des timbres et des récits d’aventures. »