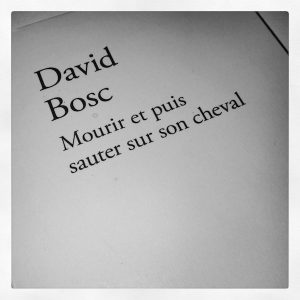de Christophe Donner.
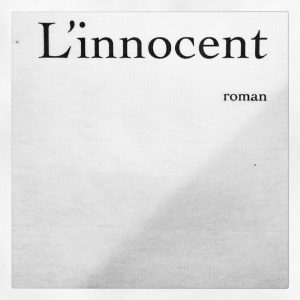 Cinquième et dernier roman lu dans le cadre du Prix du roman Fnac 2016, et pour être honnête une pointe de déception. Il n’y aura pas eu cette fois-ci de grand coup de cœur, comme le magnifique Bois Sauvage de Jesmyn Ward, ou encore le fascinant Autour de moi de Manuel Candré, lus dans des circonstances analogues en 2012.
Cinquième et dernier roman lu dans le cadre du Prix du roman Fnac 2016, et pour être honnête une pointe de déception. Il n’y aura pas eu cette fois-ci de grand coup de cœur, comme le magnifique Bois Sauvage de Jesmyn Ward, ou encore le fascinant Autour de moi de Manuel Candré, lus dans des circonstances analogues en 2012.
Mais revenons au roman, largement autobiographique si j’ai bien compris, de Christophe Donner. En toute honnêteté, on sent tout de suite qu’on a un peu affaire à un patron. Christophe Donner maîtrise complètement son sujet, l’écriture. Il utilise pour cela des bribes de son apprentissage sexuel post-soixante-huitard. Petites saynètes, fragments de souvenirs, la masturbation intensive en fil conducteur, l’écrivain navigue de conquêtes en échecs masculins ou féminins, d’histoire en éclats, dans une galaxie de personnages dont il est bien difficile de se dépêtrer. Ca n’a pas grande importance, le plus intéressant étant l’écriture, et la manière dont Christophe Donner jongle avec la narration, du il au je, en passant par le nous et le on, au gré des souvenirs plus ou moins mouvants et de la manière dont l’auteur habite sa propre histoire.
Tout ça est très bien fait, aucun doute là-dessus. Mais, à part l’intérêt pour le portrait d’une époque de libération sexuelle assez débridée, et quelques pointes d’humour et d’ironie dans la description de ses personnages, j’avoue n’avoir pas vraiment réussi à m’impliquer là-dedans. Rien de spécial à lui reprocher, juste que vraiment, ce n’est pas mon truc, je n’avais pas grand chose à faire dans cette histoire.
Ed. Grasset
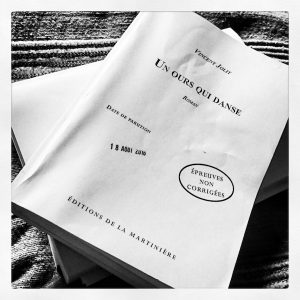 Troisième livre lu dans le cadre du Prix du roman Fnac 2016, et tout de même jusqu’à présent j’ai vraiment du bol. Parmi les quatre cent et des brouettes romans de la rentrée littéraire de septembre, il doit y avoir beaucoup de déchets, et touchons du bois, je n’ai pas l’impression d’être tombée dessus. Si, tout comme les deux livres précédents de la sélection, Un ours qui danse n’a pas fait accélérer mon rythme cardiaque au point de hurler au chef-d’oeuvre, il se lit cependant avec plaisir et intérêt. Bref, c’est tout à fait honnête.
Troisième livre lu dans le cadre du Prix du roman Fnac 2016, et tout de même jusqu’à présent j’ai vraiment du bol. Parmi les quatre cent et des brouettes romans de la rentrée littéraire de septembre, il doit y avoir beaucoup de déchets, et touchons du bois, je n’ai pas l’impression d’être tombée dessus. Si, tout comme les deux livres précédents de la sélection, Un ours qui danse n’a pas fait accélérer mon rythme cardiaque au point de hurler au chef-d’oeuvre, il se lit cependant avec plaisir et intérêt. Bref, c’est tout à fait honnête.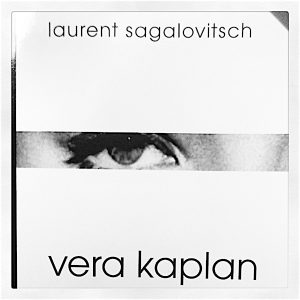 Premier livre lu dans le cadre du Prix du roman de la Fnac 2016, Vera Kaplan fait partie de ces romans très perturbants pour le critique. Bien écrit, concerné, irréprochable, Vera Kaplan laisse peu de prises, d’aspérités auxquelles s’accrocher.
Premier livre lu dans le cadre du Prix du roman de la Fnac 2016, Vera Kaplan fait partie de ces romans très perturbants pour le critique. Bien écrit, concerné, irréprochable, Vera Kaplan laisse peu de prises, d’aspérités auxquelles s’accrocher.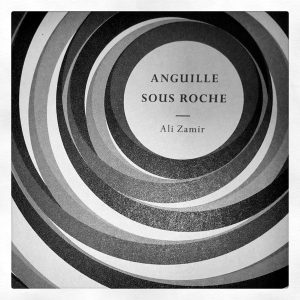 Anguille sous roche permet au lecteur curieux de réviser sa géographie et ce n’est pas la moindre de ses qualités. Ali Zamir vient des Comores, il est jeune, très jeune même, et telle l’anguille, se faufile avec aisance dans la littérature en langue française, avec ce projet d’une grande ambition et d’une maîtrise tout à fait remarquable.
Anguille sous roche permet au lecteur curieux de réviser sa géographie et ce n’est pas la moindre de ses qualités. Ali Zamir vient des Comores, il est jeune, très jeune même, et telle l’anguille, se faufile avec aisance dans la littérature en langue française, avec ce projet d’une grande ambition et d’une maîtrise tout à fait remarquable.