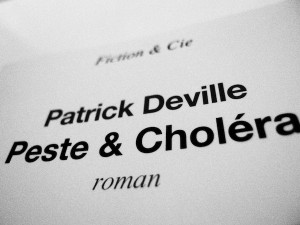d’Aurélien Bellanger.
 Quand on pose ce pavé qu’on a dévoré en deux jours, incapable de le lâcher, le sentiment qui domine, c’est l’admiration. Admiration pour la concentration de ce récit, qui malgré son ampleur, suit une route droite, tendue, opiniâtre, et utilise la thermodynamique et la physique quantique pour nous laisser enfin, la tête dans un essaim d’abeilles et le coeur brisé.
Quand on pose ce pavé qu’on a dévoré en deux jours, incapable de le lâcher, le sentiment qui domine, c’est l’admiration. Admiration pour la concentration de ce récit, qui malgré son ampleur, suit une route droite, tendue, opiniâtre, et utilise la thermodynamique et la physique quantique pour nous laisser enfin, la tête dans un essaim d’abeilles et le coeur brisé.
Aurélien Bellanger brosse le portrait de Pascal Ertanger, de son enfance à sa “dispersion”. Enfant fragile et renfermé, Pascal découvre l’informatique et le minitel, son avenir est tracé. Encore puceau il fait fortune dans le minitel rose à l’heure où ses camarades usent toujours leurs fonds de culotte sur les bancs des classes préparatoires. Mais bientôt c’est internet qui pointe son nez, et jamais avare d’un combat, Pascal se lance à la conquête de cet univers tout neuf. Et puis arrive le seuil où cela ne lui suffit plus.
L’histoire de Pascal (très librement inspirée par la biographie de Xavier Niel) donne l’occasion à Aurélien Bellanger de retracer l’histoire de la communication au XXème siècle. Ça pourrait être barbant, c’est juste fabuleux de poésie, d’ironie et de limpidité. On rentre dans le livre comme dans du beurre mou, on s’y enfonce et on s’y installe, avide de savoir ce qui au minitel succédera et comment, curieux de connaître la naissance de nos outils de communication quotidiens et addictifs, bref heureux qu’on nous raconte enfin ce qui peuple nos vies aujourd’hui comme une évidence, et qui tient finalement sur les aléatoires et vacillants précipices de la science, de la technique, de l’histoire et des hommes.
Mais tout ce grand barnum, ultra-documenté, rempli de chiffres et de science se déploie pour mieux nous raconter l’histoire du passionnant et pathétique Pascal. Parce que les avancées technologiques qui reposaient pendant longtemps dans les mains de l’Etat tout puissant et centralisateur, dérivent avec l’arrivée de l’internet, réseau explosé, sans noyau central, dans les mains d’innovants geeks, inventeurs de l’ère immatérielle, dont l’incapacité à appréhender le réel va faire passer l’Histoire, ni plus ni moins dans une nouvelle ère. On pense beaucoup au Social Network de David Fincher, où la déception amoureuse donnait naissance à Facebook. Dans la Théorie de l’information Aurélien Bellanger va encore plus loin, en faisant de son personnage et de ses semblables les fondateurs d’une vision de la post-humanité, quasiment religieuse, dans laquelle l’individu disparaît au profit des données, où l’humanité entière peut-être codée, modélisée, et continuer à vivre éternellement même après son extinction. Et c’est bien la peur, l’inadaptation fondamentale à la réalité du monde qui est à l’origine de ce délire, délire qui apparaît aujourd’hui total mais qui ne le restera sans doute pas. Alors comme tout le monde l’a dit, on pense forcément à Houellebecq, mais aussi beaucoup à Orson Scott Card et son Cycle Ender, roman de science-fiction sur fond d’insectes et de communication.
Si je n’avais pas entendu parler l’auteur de certains sujets qui me tiennent particulièrement à coeur et sur lesquels je sens poindre le désaccord profond, je n’aurais pas été loin de tomber amoureuse. Mais essayons de rester objectif (notion bien subjective) jusqu’au bout, La théorie de l’information est un livre ample et passionnant, magnifiquement écrit, qui m’a impressionnée de la première à la dernière phrase. Amen.
Ed. Gallimard