d’Haruki Murakami
On commence à avoir l’habitude des dérives murakamiennes dans les sphères de l’absurde, c’est sans doute pour ça que La course au mouton sauvage, après avoir lu Les chroniques de l’oiseau à ressort ou encore La fin de temps semble aussi léger.
 Plus court que ses deux petits frères, mais aussi beaucoup moins complexe et tortueux, La course au mouton sauvage raconte le périple d’un jeune homme détaché, globalement assez médiocre, à la recherche d’un ovin étoilé et inaccessible, sous la pression d’une organisation de l’extrême-droite japonaise. Ce mouton aurait la capacité de prendre possession d’un individu et d’en faire un surhomme capable de bâtir des empires. C’est ce qui s’est passé pour le pilier de cette organisation, mais le mouton l’a déserté et il souhaite le retrouver. Le jeune homme médiocre part alors tout bonnement, même s’il ne le sait pas encore, à la recherche de l’ambition et de la grandeur.
Plus court que ses deux petits frères, mais aussi beaucoup moins complexe et tortueux, La course au mouton sauvage raconte le périple d’un jeune homme détaché, globalement assez médiocre, à la recherche d’un ovin étoilé et inaccessible, sous la pression d’une organisation de l’extrême-droite japonaise. Ce mouton aurait la capacité de prendre possession d’un individu et d’en faire un surhomme capable de bâtir des empires. C’est ce qui s’est passé pour le pilier de cette organisation, mais le mouton l’a déserté et il souhaite le retrouver. Le jeune homme médiocre part alors tout bonnement, même s’il ne le sait pas encore, à la recherche de l’ambition et de la grandeur.
Certes pas désagréable, on trouve déjà toute la patte de Murakami dans cette histoire, dans laquelle les choses arrivent on ne sait trop comment, la réalité n’est jamais vraiment celle qu’on croit et le fantastique n’attend que le bon moment pour se manifester. Mais le roman est beaucoup moins ambitieux que ses successeurs dans l’amplitude de ses dérives, et de ses décrochements de la réalité. A part cette histoire de mouton, d’un fantôme, et d’une fille aux oreilles ensorcelantes, La course au mouton sauvage reste globalement sur la terre ferme et peine à vraiment décoller. Et si la mélancolie de l’auteur, comme d’habitude bien présente, nimbe l’histoire de sa douceur vaguement nostalgique, on regrette presque que le roman se veuille porteur d’un message, pas faux mais un peu facile et premier degré, sur la dangerosité de l’ambition et des appétits de conquête de l’homme.
Tout ça reste tout de même très recommandable, mais je continuerai malgré tout à conseiller et à offrir dans cette lignée murakamienne La fin des temps et Les chroniques de l’oiseau à ressort. A noter que la traduction de Patrick De Vos est particulièrement agréable, ce qui n’est pas toujours le cas avec les traductions d’Haruki Murakami, parfois excessivement plates. Je vous accorde toutefois que je suis fort peu apte à juger de la fidélité au texte original des traductions japonais-français…
Ed. Points
Trad. Patrick De Vos

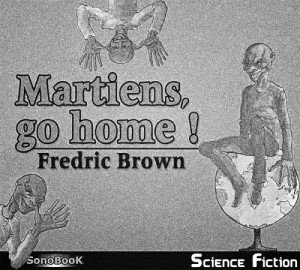
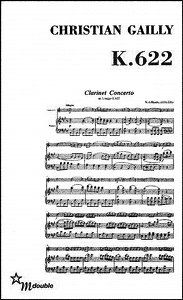
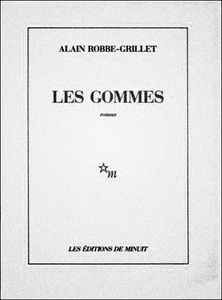 Décidément, le livre de Mathieu Lindon,
Décidément, le livre de Mathieu Lindon,