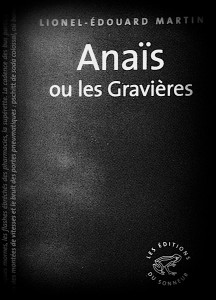de Lionel-Edouard Martin.
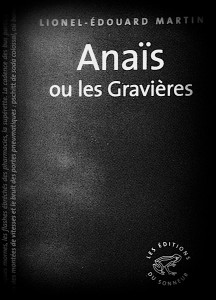 Notre narrateur est journaliste, correspondant local pour une presse poitevine, dans une ville sans nom et sans histoire. Sans histoire ou presque. Une nuit, dans un accident, Nathalie, son amoureuse est morte, ils étaient deux dans la voiture. Depuis, le journaliste survit, sans réussir à trouver le sommeil, la veille pleine des mots qu’il a dû écrire ce jour-là pour la une de son journal. Puis une jeune fille, Anaïs, meurt assassinée sur le pas de l’appartement qu’elle partage avec sa mère. A priori, rien à voir, mais Anaïs et Nathalie avaient le même âge. La mort d’Anaïs reste un mystère. Le journaliste tente de remplir les vides de cette histoire, de s’emplir des mots des autres, jusqu’à les abandonner pour choisir la voie de l’imaginaire. Sans doute ce qui lui manquait pour réussir à exorciser son mal, à cohabiter avec ses fantômes.
Notre narrateur est journaliste, correspondant local pour une presse poitevine, dans une ville sans nom et sans histoire. Sans histoire ou presque. Une nuit, dans un accident, Nathalie, son amoureuse est morte, ils étaient deux dans la voiture. Depuis, le journaliste survit, sans réussir à trouver le sommeil, la veille pleine des mots qu’il a dû écrire ce jour-là pour la une de son journal. Puis une jeune fille, Anaïs, meurt assassinée sur le pas de l’appartement qu’elle partage avec sa mère. A priori, rien à voir, mais Anaïs et Nathalie avaient le même âge. La mort d’Anaïs reste un mystère. Le journaliste tente de remplir les vides de cette histoire, de s’emplir des mots des autres, jusqu’à les abandonner pour choisir la voie de l’imaginaire. Sans doute ce qui lui manquait pour réussir à exorciser son mal, à cohabiter avec ses fantômes.
L’originalité de ce roman tient avant tout dans son écriture, d’une grande liberté. Entre oralité et poésie, sa précision frôle parfois l’abstraction, laissant au lecteur des images puissamment évocatrices en tête. L’intrigue policière n’est bien sûr qu’un prétexte, prétexte à nous présenter une galerie de personnages pittoresques, et à découvrir les réflexions de son héros. Ces réflexions sont essentiellement tournées autour de la notion de vide. Des gravières qu’on creuse pour en extirper le sable dont on fait les tours, dans lesquels des appartements-coquille-vide servent de refuge aux humains, eux-mêmes remplis du vide de la disparition. Comment combler ces vides ? et faut-il les combler ? Et avec quoi ? Autant d’interrogations qui planent sur cette histoire, ces histoires plutôt, pleines d’un mystère qu’il faut finir par accepter.
On pense au nouveau roman, bien sûr, dans cette juxtaposition de temporalités, ce puzzle géographique et temporel que le lecteur reconstitue progressivement, sans vraiment toujours réussir à faire coller les bouts. La construction est en ça très intéressante, et interroge le lecteur en permanence, faisant de lui une pièce à part entière du puzzle.
Le seul détail un peu gênant de ce beau roman, c’est cette utilisation intensive d’un vocabulaire au registre élevé. L’auteur aime passionnément les mots, les références et aime passionnément jouer avec. Cela se sent, mais cela se sent un peu trop. Je n’ai rien contre apprendre de nouveaux mots, hein, soyons clairs. Mais à trop orner son texte, à trop le bourrer de références, le lecteur se sent parfois mis à l’écart. Entre Pergolese et James Blunt, en passant par Arletty, ça fait le grand écart. Le récit mériterait d’être plus centré, centré sur ses personnages et leurs sensations, sur ces lieux magnifiquement décrits, sur la puissance poétique et cinématographique de ce style si particulier. Un bel auteur donc, dont la bibliographie déjà fournie donne envie de partir à la pêche aux trésors.
Ed. Les Editions du Sonneur
PS : il y a, dans Anaïs ou les Gravières une scène de suicide qui ne « manque pas de panache », comme diraient nos deux zigotos du Grand Soir…
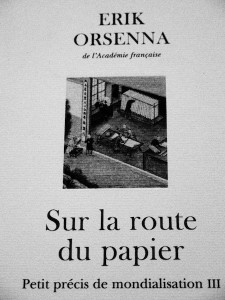 Après une réussite (Voyage aux pays du coton), et un hors-sujet (L’Avenir de l’eau), Erik Orsenna choisit l’option du ratage complet avec cette route du papier dont on ressort clairement dubitatif. Que retient-on de ce périple mondial ? Franchement pas grand chose, à part probablement une grosse dépense de kérosène, et un bilan carbone exécrable.
Après une réussite (Voyage aux pays du coton), et un hors-sujet (L’Avenir de l’eau), Erik Orsenna choisit l’option du ratage complet avec cette route du papier dont on ressort clairement dubitatif. Que retient-on de ce périple mondial ? Franchement pas grand chose, à part probablement une grosse dépense de kérosène, et un bilan carbone exécrable.