d’Ali Zamir.
Oh, la terre m’a vomie, la mer m’avale, les cieux m’espèrent, et maintenant que je reprends mes esprits, je ne vois rien, n’entends rien, ne sens rien, mais cela ne pèse pas un grain puisque je ne vaux rien, (…)
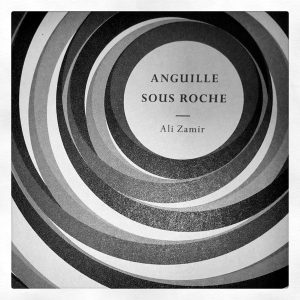 Anguille sous roche permet au lecteur curieux de réviser sa géographie et ce n’est pas la moindre de ses qualités. Ali Zamir vient des Comores, il est jeune, très jeune même, et telle l’anguille, se faufile avec aisance dans la littérature en langue française, avec ce projet d’une grande ambition et d’une maîtrise tout à fait remarquable.
Anguille sous roche permet au lecteur curieux de réviser sa géographie et ce n’est pas la moindre de ses qualités. Ali Zamir vient des Comores, il est jeune, très jeune même, et telle l’anguille, se faufile avec aisance dans la littérature en langue française, avec ce projet d’une grande ambition et d’une maîtrise tout à fait remarquable.
Une jeune fille se noie dans l’océan, elle s’appelle Anguille, et entre deux clapots nous raconte son histoire, ce qui l’a menée aux portes de la mort dans les eaux obscures où tant ont déjà péri. Dans un souffle, une phrase unique, Anguille affirme sa force et sa liberté de femme, envers et contre tous, la société, la famille.
Ce qui est magnifique dans Anguille sous roche, c’est cette langue unique, foisonnante, qui donne à entendre des voix peu entendues jusqu’à présent et qui ont pourtant des choses à dire et affirmer. Entre virtuosité échevelée et sens de l’expression populaire, Ali Zamir nous offre une langue fabuleusement colorée, vivante, une langue en mouvement. L’univers qu’il réussit à décrire ne manque pas d’intérêt non plus, personnages forts, tous remarquablement dessinés, géographie urbaine fascinante.
Mais ce qui met le lecteur KO, c’est clairement cette énergie qui dévaste tout, cette manière d’aller de l’avant, de « rentrer dedans » sans se poser de question. J’ai pensé souvent à la très différente mais tout à fait fabuleuse écriture d’Emmanuelle Bayamack-Tam, dans cette façon dévorante d’avancer, ce raz-de-marée d’énergie et de force vitale qui déborde de partout.
Anguille sous roche est une magnifique découverte et une très bonne nouvelle pour la langue française, elle n’est pas morte, elle est vivante, elle bouge encore.
(…) mon père Connaît-Tout croit vraiment connaître tout (…)
Ed. Le Tripode.
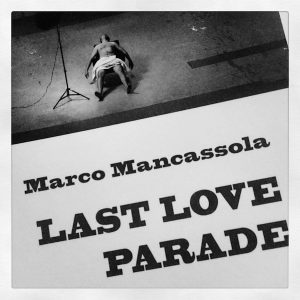 A l’origine, c’est l’histoire d’un malentendu. Parce que vous voyez, musicalement parlant je suis plutôt du genre éclectique. Mais s’il y a quelque chose qui, non seulement me passe au dessus de la tête, mais qui aurait tendance à me pousser à m’abonner à Boules Quiès mag’, c’est bien la dance, la techno, tout ce fatras de synthés et boîtes à rythmes auquel, soyons honnêtes, je n’y comprends nib.
A l’origine, c’est l’histoire d’un malentendu. Parce que vous voyez, musicalement parlant je suis plutôt du genre éclectique. Mais s’il y a quelque chose qui, non seulement me passe au dessus de la tête, mais qui aurait tendance à me pousser à m’abonner à Boules Quiès mag’, c’est bien la dance, la techno, tout ce fatras de synthés et boîtes à rythmes auquel, soyons honnêtes, je n’y comprends nib.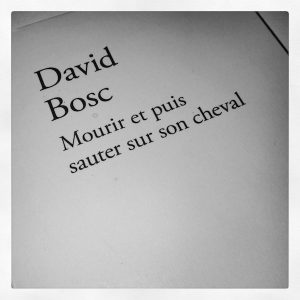
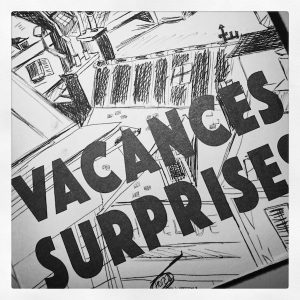 Il s’en est fallu de très peu pour que je ne prenne pas la peine de vous parler de ce petit recueil de chroniques, écrites entre 1957 e 1960 par un lauréat du prix Goncourt bien oublié aujourd’hui.
Il s’en est fallu de très peu pour que je ne prenne pas la peine de vous parler de ce petit recueil de chroniques, écrites entre 1957 e 1960 par un lauréat du prix Goncourt bien oublié aujourd’hui.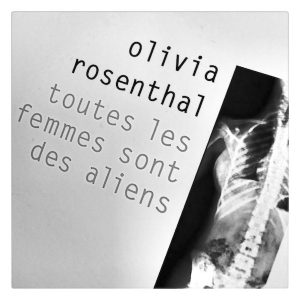 Quand je serai grande je veux écrire comme Olivia Rosenthal. Non mais sans rire. Chaque fois qu’un de ses livres me tombe entre les mains, c’est un raz-de-marée émotionnel. L’univers de cet auteur me bouleverse, sa manière pudique d’en parler par des constructions littéraires hyper contrôlées m’enthousiasme. Voilà. Olivia Rosenthal c’est quelqu’un qui a tout compris de la puissance de la littérature et qui trouve mille chemins pour parler de choses profondes et intimes. C’est juste super beau.
Quand je serai grande je veux écrire comme Olivia Rosenthal. Non mais sans rire. Chaque fois qu’un de ses livres me tombe entre les mains, c’est un raz-de-marée émotionnel. L’univers de cet auteur me bouleverse, sa manière pudique d’en parler par des constructions littéraires hyper contrôlées m’enthousiasme. Voilà. Olivia Rosenthal c’est quelqu’un qui a tout compris de la puissance de la littérature et qui trouve mille chemins pour parler de choses profondes et intimes. C’est juste super beau.