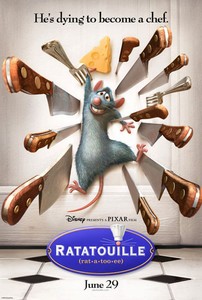de Claude Chabrol

C’est avec beaucoup de bonheur que je suis allée voir le dernier film de Claude Chabrol, c’est avec ravissement que j’en suis sortie. Dans le terrain toujours bien balisé du monde de la haute bourgeoisie, dont Chabrol aime disséquer les moeurs, souffle un vent de fraîcheur, incarné par la décidément délicieuse Ludivine Sagnier.
 Comme à son habitude Chabrol joue allègrement avec les noms de famille de ses personnages, son ange blond, hitchocko-allenien s’appelle Gabrielle Deneige, et sur les ondes locales de la télévision lyonnaise, présente les prévisions météorologiques. Elle incarne cette nouvelle élite française, l’élite télévisuelle, qui écrase les anciennes idoles bourgeoises et intellectuelles. Mais Gabrielle Deneige est finalement loin du cliché de l’écervelée à l’ambition dévorante. Attirée par un écrivain intellectuel et pervers, Charles Saint-Denis (interprété par François Berléand, implacable), c’est en toute innocence, ou plutôt sincérité, qu’elle se livre à ses pratiques sexuelles particulières. Ayant rempli le cahier des charges, comme de bien entendu, la bête abandonne la belle. Gabrielle, désespérée, accepte alors de se marier avec un fils à papa fou d’amour et fou tout court. Magimel est assez magistral, dans un rôle incroyablement savonnette. Personnage profondément ridicule, Paul Gaudens (ah Chabrol, tu as le génie des noms) est pourtant fort inquiétant, car sur le fil de la raison en permanence. Un fois Gabrielle mariée à la famille Gaudens, l’homme perverti au nom de Saint, sera tué par l’homme de haute lignée au nom d’accessoire divin. Mais chez Chabrol, comme dans la vie, il n’y a pas de justice, et l’archange blond et déchu, livré en pâture à la vindicte populaire et médiatique, expiera pour les crimes des autres, pour mieux renaître, sous le feu de projecteurs plus modestes, mais plus sincères d’un spectacle de cirque.
Comme à son habitude Chabrol joue allègrement avec les noms de famille de ses personnages, son ange blond, hitchocko-allenien s’appelle Gabrielle Deneige, et sur les ondes locales de la télévision lyonnaise, présente les prévisions météorologiques. Elle incarne cette nouvelle élite française, l’élite télévisuelle, qui écrase les anciennes idoles bourgeoises et intellectuelles. Mais Gabrielle Deneige est finalement loin du cliché de l’écervelée à l’ambition dévorante. Attirée par un écrivain intellectuel et pervers, Charles Saint-Denis (interprété par François Berléand, implacable), c’est en toute innocence, ou plutôt sincérité, qu’elle se livre à ses pratiques sexuelles particulières. Ayant rempli le cahier des charges, comme de bien entendu, la bête abandonne la belle. Gabrielle, désespérée, accepte alors de se marier avec un fils à papa fou d’amour et fou tout court. Magimel est assez magistral, dans un rôle incroyablement savonnette. Personnage profondément ridicule, Paul Gaudens (ah Chabrol, tu as le génie des noms) est pourtant fort inquiétant, car sur le fil de la raison en permanence. Un fois Gabrielle mariée à la famille Gaudens, l’homme perverti au nom de Saint, sera tué par l’homme de haute lignée au nom d’accessoire divin. Mais chez Chabrol, comme dans la vie, il n’y a pas de justice, et l’archange blond et déchu, livré en pâture à la vindicte populaire et médiatique, expiera pour les crimes des autres, pour mieux renaître, sous le feu de projecteurs plus modestes, mais plus sincères d’un spectacle de cirque.
 Il y a un plaisir évident, une jouissance absolue de raconter une histoire, à montrer très peu pour dire beaucoup. Le film est d’une finesse totale dans ses détails (finesse n’est finalement pas le terme le plus adapté…), que ce soient dans les dialogues, les noms des personnages, leurs comportements même infimes, les décors. Ici, un obélisque miniature trône devant une photo d’une postérieure nudité, là un petit frôlement de doigt suggère qu’entre l’éditrice (Mathilda May, vivante et ma foi troublante) et l’écrivain, les rapports vont au-delà de l’amicalement correct. C’est d’une perversité chaste exquise, grinçante et réjouissante. Le générique arborant environ quatre noms et demi, l’ensemble possède un certain côté placo-plâtre propre à Chabrol. Il a pourtant apporté plus de soin que dans sa médiocre Ivresse du pouvoir, au cadre, et réussi à composer quelques plans assez jolis, tout en jeux de miroirs.
Il y a un plaisir évident, une jouissance absolue de raconter une histoire, à montrer très peu pour dire beaucoup. Le film est d’une finesse totale dans ses détails (finesse n’est finalement pas le terme le plus adapté…), que ce soient dans les dialogues, les noms des personnages, leurs comportements même infimes, les décors. Ici, un obélisque miniature trône devant une photo d’une postérieure nudité, là un petit frôlement de doigt suggère qu’entre l’éditrice (Mathilda May, vivante et ma foi troublante) et l’écrivain, les rapports vont au-delà de l’amicalement correct. C’est d’une perversité chaste exquise, grinçante et réjouissante. Le générique arborant environ quatre noms et demi, l’ensemble possède un certain côté placo-plâtre propre à Chabrol. Il a pourtant apporté plus de soin que dans sa médiocre Ivresse du pouvoir, au cadre, et réussi à composer quelques plans assez jolis, tout en jeux de miroirs.
Comme Woody Allen, la jeunesse féminine et blonde lui redonne un souffle créatif évident, et la dernière plan en est un hommage criant. En cette moitié d’année 2007, et heure de moitié de bilan, il devient de plus en plus évident, que c’est dans les plus vieilles gamelles qu’on fait la meilleure soupe, qu’il y a plus de cinéma chez les Chabrol et Téchiné, que chez beaucoup de petits jeunes. Pas forcément très rassurant pour la suite…