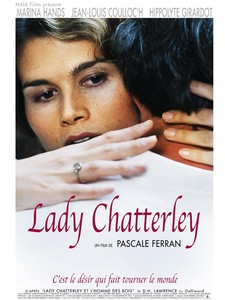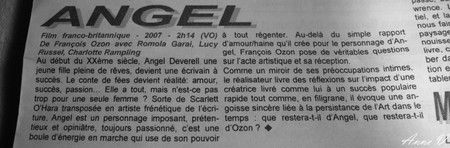de Jérôme Bonnell (J’attends quelqu’un)
 Voilà un bien joli film, tout en finesse. Quelques personnages, qui se connaissent ou pas, se croisent, ou pas. Un patron de bistrot (Jean-Pierre Darroussin, Darroussinesque à mort, et tendre comme du beurre) un peu lourdingue et libidineux est vaguement amoureux d’une petite pute grosse comme une allumette (très touchante Florence Loiret avec son physique de mouette). La sœur est une instit coquine et fofolle qui bouffe des carottes au lit (Emmanuelle Devos qui a rarement été si belle). Elle est mariée avec un journaliste détaché, hypocondriaque et mollasson du gland, mais qui prend sa femme en photo quand elle dort (Eric Caravaca, benêt à souhait).
Voilà un bien joli film, tout en finesse. Quelques personnages, qui se connaissent ou pas, se croisent, ou pas. Un patron de bistrot (Jean-Pierre Darroussin, Darroussinesque à mort, et tendre comme du beurre) un peu lourdingue et libidineux est vaguement amoureux d’une petite pute grosse comme une allumette (très touchante Florence Loiret avec son physique de mouette). La sœur est une instit coquine et fofolle qui bouffe des carottes au lit (Emmanuelle Devos qui a rarement été si belle). Elle est mariée avec un journaliste détaché, hypocondriaque et mollasson du gland, mais qui prend sa femme en photo quand elle dort (Eric Caravaca, benêt à souhait).
 Film choral comme il y en a beaucoup et pourtant… Dans J’attends quelqu’un, il y a plein d’amour et d’attention entre ces êtres, mais un amour qui n’arrive pas à s’exprimer, ils sont avides des autres sans vraiment oser se parler vraiment. Tout le monde est surpris que le bistortier lise l’Education Sentimentale, qu’il a pourtant ingurgité 4 fois. Par pudeur, il dira que c’est parce que Flaubert est né à la même date que lui. On se tourne autour, on s’aime, on se quitte et puis on se retrouve aussi, et puis ouvrant le champ des possibles la dame aux chiens qu’on aperçoit par intermittence dans le fond de l’image 5 ou 6 fois dans le film, ose entrer dans le bistrot, une nouvelle rencontre.
Film choral comme il y en a beaucoup et pourtant… Dans J’attends quelqu’un, il y a plein d’amour et d’attention entre ces êtres, mais un amour qui n’arrive pas à s’exprimer, ils sont avides des autres sans vraiment oser se parler vraiment. Tout le monde est surpris que le bistortier lise l’Education Sentimentale, qu’il a pourtant ingurgité 4 fois. Par pudeur, il dira que c’est parce que Flaubert est né à la même date que lui. On se tourne autour, on s’aime, on se quitte et puis on se retrouve aussi, et puis ouvrant le champ des possibles la dame aux chiens qu’on aperçoit par intermittence dans le fond de l’image 5 ou 6 fois dans le film, ose entrer dans le bistrot, une nouvelle rencontre.
 Filmé très simplement, souvent en plans fixes, le film laisse le temps au spectateur de ressentir toutes les nuances des relations entre les êtres, leurs fragilités, leur blessures. Jamais démonstratif, en même temps mélancolique et d’une grande luminosité, J’attends quelqu’un, accompagné discrètement par les très jolies pièces pour piano de Grieg, touche au plus profond des aspirations de l’être humain, et c’est beau comme tout.
Filmé très simplement, souvent en plans fixes, le film laisse le temps au spectateur de ressentir toutes les nuances des relations entre les êtres, leurs fragilités, leur blessures. Jamais démonstratif, en même temps mélancolique et d’une grande luminosité, J’attends quelqu’un, accompagné discrètement par les très jolies pièces pour piano de Grieg, touche au plus profond des aspirations de l’être humain, et c’est beau comme tout.