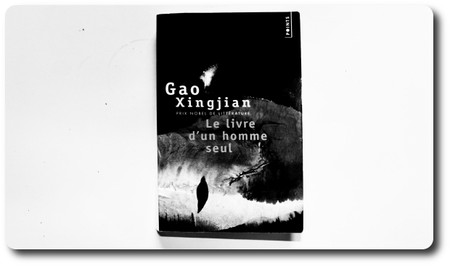de Gao Xingjian.
Chers lecteurs, happy few, là, et regardez-moi dans les yeux quand je parle, je vous ordonne de courir séance tenante chez votre libraire préféré pour vous procurez Le Livre d’un homme seul. Ce bouquin est ce que j’ai lu de plus bouleversant depuis un bail (depuis La possibilité d’une île en fait), il arrive à un moment où j’en avais besoin, et je ne suis pas trop sûre de réussir à trouver les mots.
Hong-Kong, un peu avant la rétrocession, un écrivain chinois, réfugié politique en France, une juive allemande plantureuse font l’amour. Ils se connaissent un peu, un tout petit peu, d’avant, quand il était encore en Chine. Progressivement, à l’exploration des corps, succède l’exploration du passé de cet homme. Elle pose des questions, essaie de remuer le passé de l’écrivain, de faire se réveiller des souvenirs qu’il s’est toujours efforcé d’enfouir. Il renâcle, distille les informations par petites touches disparates. Ils se séparent au bout de quelques jours. Il voudrait continuer comme avant, mais il ne peut pas, obligé de coucher sur papier ce passé bouleversé. Il ne peut pas dire « je », mais alternera le « il » pour relater les événements, le « tu » pour conter ses réflexions et parler de lui au présent. Cette distinction lui permet d’examiner son passé avec distance, de faire de lui un autre, un quasi étranger dont il est plus simple de raconter l’histoire.
Deux portraits se détachent : celui d’un pays, la Chine, devenu fou, aux mains de Mao, du Parti, des révolutions, des contre-révolutions, des rebelles, des cadres du parti, des cadres anti-parti, et celui d’un homme, muselé, condamné à marcher au pas, à porter un « masque », à abandonner sa liberté pour survivre, victime, mais aussi acteur de l’Histoire. Et c’est bouleversant, la façon dont cet homme apprend à ployer, à dissimuler en permanence ce qu’il est, un esprit libre. C’est aussi sans doute la raison de ce « il » employé pour raconter son histoire, ce n’était pas son vrai moi qui se mouvait dans ce monde bousculé, mais un menteur, un dissimulateur forcé. Il est sauvé par ses talents de dissimulateur, beaucoup de chance, son amour de la vie et son amour des femmes.
Les femmes, il n’y a d’ailleurs que ça qui ne change pas vraiment dans sa vie actuelle, sa vraie vie. Amoureux des femmes, et surtout du corps des femmes et du sexe, ses rapports avec elles sont troubles, cruels, mais aussi assez beaux. A part les femmes, son « exil » en France a été un changement total, une libération, il a enfin pu écrire, et surtout conserver ses écrits, sans crainte d’être dénoncé. Ses réflexions sur l’écriture, sa nécessité, besoin vital, refuge essentiel, espace d’une liberté infinie sont des passages fondamentaux, mêlant l’intellectuel et une pulsion initiale de vie, qui, finalement, tente d’approcher un petit quelque chose de l’humanité. Immense manifeste pour la liberté d’expression, et donc la liberté d’être, sans contrainte, je vous conjure de vous plonger dans le Livre d’un homme seul. Pour vous convaincre, un tout petit extrait.
« Tu n’écris pas dans le but de faire de la littérature pure, mais tu n’es pas non plus un combattant, tu n’utilises pas ta plume comme une arme pour réclamer justice – de toute façon, tu ne sais pas où est la justice – (…). Si tu écris, ce n’est que pour dire que cette vie a existé, plus infecte qu’un bourbier, plus réelle qu’un enfer imaginé, plus effrayante que le jugement dernier, et qu’elle risque de revenir un jour ou l’autre une fois que son souvenir ce sera estompé. »
Merci Monsieur Xingjian.