de François Beaune.
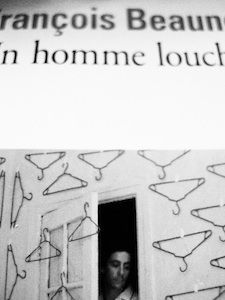 Unique, c’est le mot qui vient à l’esprit quand on lit Un homme louche. Un univers unique, un style unique. Dès son premier roman François Beaune impose sa griffe, mine de rien, derrière une apparente légèreté d’écriture et de ton.
Unique, c’est le mot qui vient à l’esprit quand on lit Un homme louche. Un univers unique, un style unique. Dès son premier roman François Beaune impose sa griffe, mine de rien, derrière une apparente légèreté d’écriture et de ton.
Jean-Daniel Dugommier est un adolescent mutique et solitaire. Sa seule réelle compagnie, c’est ce cahier dans lequel il écrit son journal. Regard noir sur le monde, parfois complètement à côté de la plaque, et souvent inquiétant, c’est avec sérieux que Jean-Daniel raconte sa vision des choses, ses projets. On navigue dans un univers où éclairs de lucidité sur le fonctionnement du monde, et délires complets se côtoient. Car jean-Daniel ne va tout de même pas très bien, et son comportement finit d’ailleurs par le faire interner, puis intégrer un collège spécialisé. Près de vingt ans plus tard, on retrouve notre personnage. En apparence, un homme assez banal, un travail, un appartement, des amis de bistrot. On comprend peu à peu les événements qui se sont produits entre ces deux périodes de sa vie. Et on comprend aussi que Jean-Daniel, au moment où il recommence à raconter sa vie ne va à nouveau pas très bien dans sa tête.
Pourtant, ce qui capte l’attention quand on commence le livre, c’est sa drôlerie. Jean-Daniel est globalement bien à côté de la plaque, et les réflexions qu’il se fait sur la vie, l’amour, en cette période adolescente où tout remue à l’intérieur, sont vraiment très rigolotes. Ca part dans tous les sens, la galerie de personnages qu’il dresse est assez inénarrable. Le “réel” est complètement déformé, transformé, amplifié. A force de se focaliser sur les détails, les constituants d’un grand tout, d’expérimenter à tout va, Jean-Daniel se crée un monde totalement autre, dans lequel la logique commune n’a pas vraiment sa place. Il a pourtant l’âme d’un scientifique, et ses observations des gens qui l’entourent, sont faites de manière très sérieuse. Et si ses réflexions décalées sont drôles, le sourire pourtant se mue en crainte assez rapidement. Car cet adolescent, tout entier bouffé par sa psychose et sa paranoïa, bien que parfois d’une lucidité terrifiante, est une vraie bombe à retardement (au moins pour lui-même). Sa détestation de soi va très loin, et pour éviter de rester trop longtemps en sa propre compagnie, il passe son temps à observer les autres.
Adulte, en apparence “calmé”, il recommence pourtant à se placer en dehors du monde, il ne parvient toujours pas à se positionner dans l’espace. Il théorise (la “sous-réalité”, ou « l’idéale réalité St Nectaire« ), échafaude des plans de “fuite” : Moi qui ne fais qu’observer, qui ne veux rien avoir à faire avec le monde, je me paye ce fantasme d’un jour avoir la force de le renverser. Dans la deuxième partie du roman, c’est la tristesse qui prend le pas sur le rire. Bien sûr, l’humour noir est toujours présent, mais ce qui apparaît de cet homme, en filigrane, sa vision de la vie, sa solitude, sont bouleversants. Comment se reconstruire une vie après ce qu’il a vécu ? Et surtout pourquoi faire ? Impossible de ne pas être remué par ce personnage qui nous dit que sa première émotion réelle, durable, a été la honte. Homme tout en vrac à l’intérieur dès la naissance, Jean-Daniel tente malgré tout de rationaliser son univers. Cette quête de repères, quasi clinique, est juste très émouvante. Comment essayer de recoller les morceaux du monde, pour recoller les morceaux de soi, et tenter d’exister, au moins un tout petit peu. Finalement, on est tous un peu des Jean-Daniel Dugommier quelque part non ?
Roman, pudique, presque modeste, Un homme louche impose François Beaune comme un auteur à part, et très prometteur de la littérature française. Chapeau bas.
Pour la route quelques citations :
“L’homme est né libre, et partout il est dans les fers” (ou dans le cuir pour un fétichiste)
Ce reflet de vernis de blanc d’oeuf intense. Qu’est-ce qu’un poussin en comparaison, la jeunesse imparfaite ?
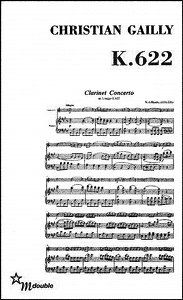
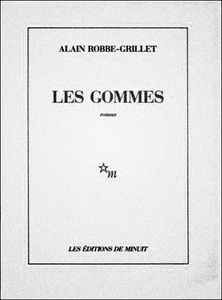 Décidément, le livre de Mathieu Lindon,
Décidément, le livre de Mathieu Lindon, 
 Sous ce titre en forme de gag, se cache un excellent livre de Marco Mancassola. Imaginez que les super-héros existent vraiment, et ont vraiment, pendant des décennies, sauvé le monde. Aujourd’hui, ils sont vieillissants, dignes ou ridicules, reconvertis ou à la retraite. Mais une menace pèse sur eux, et un à un, ils se font tuer par un mystérieux groupuscule terroriste.
Sous ce titre en forme de gag, se cache un excellent livre de Marco Mancassola. Imaginez que les super-héros existent vraiment, et ont vraiment, pendant des décennies, sauvé le monde. Aujourd’hui, ils sont vieillissants, dignes ou ridicules, reconvertis ou à la retraite. Mais une menace pèse sur eux, et un à un, ils se font tuer par un mystérieux groupuscule terroriste.