d’Alain Robbe-Grillet.
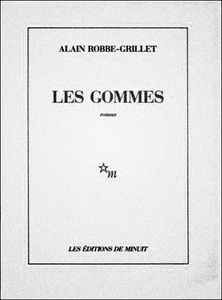 Décidément, le livre de Mathieu Lindon, Ce qu’aimer veut dire, m’aura fait découvrir de bien belles choses. Après l’Homme sans postérité d’Adalbert Stifter, voilà que je termine un roman d’Alain Robbe-Grillet. J’avoue honteusement que je n’aurais sans doute jamais songé à lire cet auteur spontanément.
Décidément, le livre de Mathieu Lindon, Ce qu’aimer veut dire, m’aura fait découvrir de bien belles choses. Après l’Homme sans postérité d’Adalbert Stifter, voilà que je termine un roman d’Alain Robbe-Grillet. J’avoue honteusement que je n’aurais sans doute jamais songé à lire cet auteur spontanément.
Nous voilà donc plongés au coeur d’une intrigue policière qui devrait être sans réelle surprise ni suspense, puisque le narrateur, naviguant d’un personnage à l’autre nous dévoile rapidement les tenants et les aboutissants de l’affaire. Dans une ville moyenne et tranquille, à la géométrie compliquée, Daniel Dupont, un professeur est victime d’une tentative d’assassinat par un groupuscule. Il en réchappe, mais préfère cependant, grâce à la complaisance d’un docteur peu regardant, que tout le monde le croit mort. La police locale jette l’éponge assez vite malgré les incohérences de l’enquête et un agent secret parisien, Wallas, débarque dans cette ville pour tenter de démasquer les coupables. Un point de départ somme toute assez classique mais qui pourtant donne lieu à un roman fascinant.
Wallas parcourt la ville à pied, de long en large et en travers pour interroger les protagonistes de cette histoire, l’ex-femme du professeur, une voisine curieuse, le médecin louche qui l’a soigné, la vieille bonne sourde comme un pot, le commissaire circonspect. Et à mesure que Wallas arpente la ville, se perd et dans le temps (sa montre est cassée), et dans l’espace (il n’a pas de plan et se fie à son sens de l’orientation parfois défaillant), et dans ses pensées, le lecteur se perd aussi. Le récit, pourtant condensé dans une ville unique et sur une seule journée, et bien que relativement chronologique fait perdre tous repères au lecteur. Le point de vue mouvant du narrateur nous donne à entrer dans la tête de chacun des personnages, et à suivre leurs pensées et suppositions. Comment dans ces cas là réussir à démêler le vrai de l’imaginaire ? Doit-on vraiment faire confiance à ces gens et à ce Wallas ? Les indices ne manquent pas pour perdre toute confiance en son histoire : sa photo de carte d’identité ne lui ressemble pas, il a les traits de l’assassin présumé de Daniel Dupont. Et pourtant il a l’air sincère. Est-il seulement manipulé ?
L’esprit du lecteur est donc en perpétuel éveil pour réussir à donner forme et cohérence à ce récit qui fait tout pour nous perdre. La manière de procéder d’Alain Robbe-Grillet est assez fascinante, avec ces réminiscences de conversations qui se répètent d’un lieu à l’autre, de ces scènes visiblement pareilles et pourtant légèrement différentes. On sent qu’on ne peut pas vraiment faire confiance à ce qu’on lit, et c’est très perturbant, tant notre esprit est habitué à prendre pour argent comptant ce qu’on lui donne à voir et à lire. Le procédé m’a fait un peu penser à un film du grand Hitchcock, je crois qu’il s’agit du Grand Alibi de 1950, mais pas sûre, dans lequel le réalisateur nous montre un flash-back complètement mensonger, et qu’on gobe avec une facilité déconcertante. C’est fascinant de voir à quel point le lecteur/spectateur est dépendant de ce qu’on lui donne à lire et à voir. Et Alain Robbe-Grillet use très bien de ses talents de manipulateur et les affiche clairement. Il ne prend pas ses lecteurs pour des idiots, bien au contraire, et joue à nous perdre dans le labyrinthe circulaire des rues de la ville et des heures. Le thème du labyrinthe est un théme cher au Nouveau Roman, et j’en avais déjà parlé à propos du magnifique Emploi du temps de Michel Butor.
On retrouve clairement dans les Gommes (antérieur de trois années à l’Emploi du temps) les mêmes questionnements, la même volonté de bousculer le lecteur, de l’amener à accepter la perte de repères, de finalement dépasser le stade de la passivité face à l’écriture. Alors certes le style en lui-même a sans doute un petit peu vieilli, on utilise certes plus aujourd’hui de télégrammes et de tubes pneumatiques, mais franchement, face à une telle construction, et une telle intelligence, je m’incline avec un respect infini.

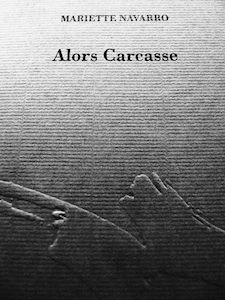
 Perplexité, agacement, ce sont les mots qui me sont venus à l’esprit en cours de lecture. Ce que j’appelle oubli, très court roman (à peine 60 pages écrites en police 18, à peine une nouvelle en fait), publié bien entendu, par les Editions de Minuit, laisse un goût amer dans la bouche. Pourtant, je me doute bien qu’il est sûrement de très mauvais goût d’oser émettre des doutes en ce qui concerne les intentions de l’auteur, tant le fait divers sur lequel il s’appuie est effectivement abominable, insupportable, inadmissible.
Perplexité, agacement, ce sont les mots qui me sont venus à l’esprit en cours de lecture. Ce que j’appelle oubli, très court roman (à peine 60 pages écrites en police 18, à peine une nouvelle en fait), publié bien entendu, par les Editions de Minuit, laisse un goût amer dans la bouche. Pourtant, je me doute bien qu’il est sûrement de très mauvais goût d’oser émettre des doutes en ce qui concerne les intentions de l’auteur, tant le fait divers sur lequel il s’appuie est effectivement abominable, insupportable, inadmissible.